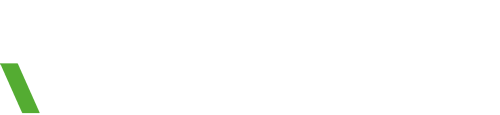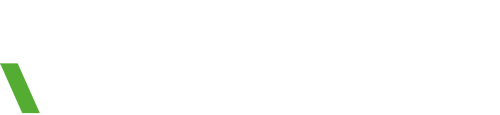Le Sdage 2022-2027 affiche l’ambition d’amener 52 % des cours d’eau et eaux littorales du bassin au bon état écologique au sens des normes européennes à l’horizon 2027 (contre 32% aujourd’hui) et 32 % des eaux souterraines en bon état chimique. Le comité de bassin a également donné un avis favorable au programme de mesures qui soutiendra la mise en œuvre du Sdage. Chiffré à 6,2 milliards d’euros, ce qui est proche du rythme financier des investissements actuels, il se caractérise par une augmentation des investissements pour réduire les pollutions issues de l’agriculture, des ruissellements issus des eaux pluviales ou pour agir sur les altérations physiques des cours d’eau.
PUBLICITÉ
Dans l’orientation de ce Sdage figurent l’amélioration de l’hydromorphologie (rivières et zones humides), qui constitue le premier risque de dégradation des cours d’eau ; la diminution des pollutions diffuses (majoritairement nitrates et pesticides), 2e facteur de dégradation, et en particulier la protection des aires de captages ; la diminution des macro et micropolluants ponctuels, avec la gestion du temps de pluie ; une meilleure anticipation des déséquilibres quantitatifs, qu’il s’agisse des sécheresses ou des inondations ; la protection du littoral en termes de qualité des eaux et vis-à-vis de la montée du niveau marin.
Compenser, anticiper, diminuer
Des mesures assez ambitieuses liées au contexte de changement climatique, d’accroissement de la population, de développement de l’activité économique sont fixées afin de conserver, ou améliorer la qualité des milieux aquatiques et des eaux souterraines. Par exemple : compenser la destruction des zones humides par des reconstitutions à hauteur de 150 à 200 % de la surface détruite ; inciter les collectivités à travailler en étroite collaboration avec les exploitants agricoles pour mieux protéger les captages d’alimentation en eau potable et développer l’agriculture biologique et à bas niveaux d’intrants ; pour permettre l’atteinte de l’objectif du zéro artificialisation nette des sols, compenser toute nouvelle surface imperméabilisée à hauteur de 100 à 150 % ; anticiper les tensions à venir sur les quantités d’eau disponible, en l’économisant et en définissant les modalités de partages entre les usages ; diminuer les flux d’azote apportés à la mer par les fleuves pour réduire les échouages d’algues sur le littoral, ce qui implique une mobilisation sur tout le territoire du bassin.
Pollutions dues aux eaux pluviales et d’origine agricole en augmentation
Le montant du programme de mesures de 6,2 milliards est proche du rythme financier actuel d’investissement, mais sa répartition évolue par rapport à la période 2016-2021. Les travaux réalisés sur les stations de traitement des eaux usées ont été efficaces. Toutefois, d’autres pressions se sont accrues, par exemple les pollutions dues au ruissellement des eaux pluviales, les pollutions diffuses d’origine agricole (pesticides et nitrates) ou les altérations physiques des cours d’eau. Ainsi, la part des mesures et des financements pour ces domaines augmente.