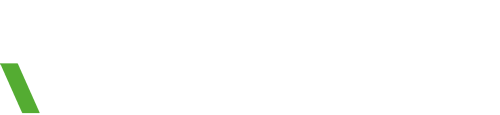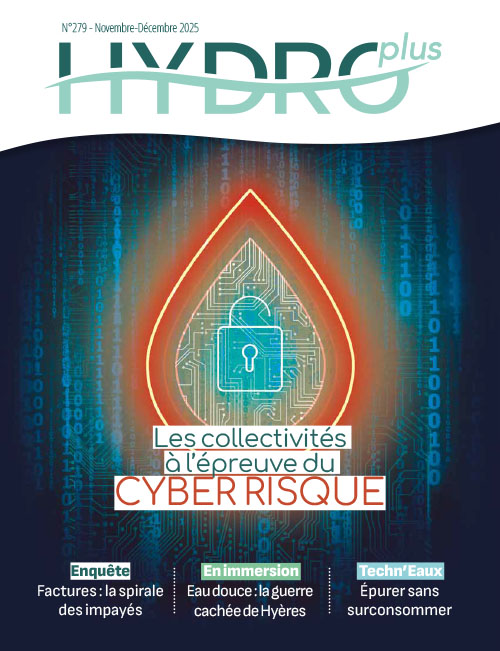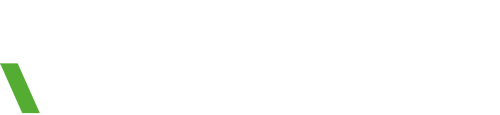On assiste depuis quelques mois à un réveil des consciences sur l’eau. Il faut dire qu’avec la multiplication des sècheresses et la menace grandissante de pénuries d’eau, il y a de quoi s’inquiéter. Qui plus est quand on sait que notre réseau d’eau est largement vieillissant, avec plus de 50% des réseaux installés avant les années 1970, et 1 litre sur 5 d’eau en moyenne perdu en raison de fuites.
PUBLICITÉ
Ni trop tôt, ni trop tard ... la rénovation des réseaux d’eau, c’est avant tout une question de timing
Une fuite d’eau n’est jamais une bonne nouvelle. Parce que c’est une perte en eau, et que nous devons préserver au mieux cette ressource, d’autant plus à l’heure où le changement climatique et l’augmentation de l’activité humaine la mettent sous pression, partout sur la planète.
Mais une fuite d’eau, c’est aussi, à l’échelle d’un réseau et à partir d’un certain débit, un risque sur les équipements environnants, qui peut aller jusqu’au scenario catastrophe en cas de rupture d’une canalisation structurante. Dans le même temps, réparer une fuite sur son réseau est toujours une opération délicate pour une collectivité. Parce que cela implique des travaux conséquents, les réseaux d’eau étant enterrés sous les voiries, souvent à proximité d’autres réseaux sensibles, comme le gaz ou l’électricité. Et parce que ces travaux, entre les gros budgets qu’ils mobilisent et les nuisances qu’ils occasionnent pour les usagers, ont rarement bonne presse.
L’enjeu principal réside pour les collectivités dans le pilotage aigu du bon timing : pas trop tard, pour éviter les accidents, mais pas trop tôt non plus, pour n’opérer les travaux que lorsqu’ils sont nécessaires.
Un exercice d’équilibriste qui implique de bien connaitre son réseau, et même de prédire l’avenir
Pour garantir ce bon timing, les collectivités doivent avoir une meilleure connaissance de leur réseau. Car la « stratégie du pansement », qui consiste à intervenir de manière localisée sur une fuite pour la réparer, montre vite ses limites.
Bien souvent d’ailleurs, les fuites sont les signes précurseurs d’une éventuelle défaillance mécanique à venir et d’une faiblesse plus profonde de la canalisation, et la réparer sans une analyse plus complète de son origine ne fait que déplacer le problème, et peut provoquer, à plus ou moins court terme, une autre fuite dans la même zone.
Si la fuite est la conséquence de la faiblesse du réseau, et non sa cause, alors, en réalisant un diagnostic plus complet de leurs canalisations, basé sur des données fiables, les régies, les autorités concédantes et leurs concessionnaires adoptent une véritable stratégie de gestion patrimoniale à long terme.
Et en s’appuyant sur les robots aujourd’hui disponibles pour identifier et qualifier les défauts (corrosion, ovalisation), et pour étudier le comportement structurel de chaque tronçon d’une conduite dans son environnement (mesure de la pression de service, contrôle de la conception, analyse d’ingénierie), elles peuvent également cibler et planifier les futurs travaux, et même prédire la durée de vie restante de leur patrimoine, afin de mieux gérer leur budget de travaux ou de renouvellement tout en limitant les nuisances pour les usagers.
Détecter les fuites est essentiel mais ne suffit plus. Pour mieux gérer notre réseau d’eau, les collectivités doivent réaliser des diagnostics structurels des réseaux. Objectif ? Passer d’une approche curative à une approche prédictive, pour adopter de véritables stratégies de gestion patrimoniale à long terme de nos réseaux, et ainsi permettre une gestion plus efficiente et plus durable de l’eau qui coule sous nos pieds.