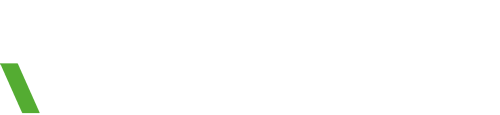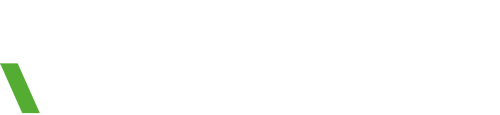Les façades des bâtiments sont rarement « juste » des façades. Elles jouent un rôle social insoupçonné dans l’imaginaire collectif, entre fonction protectrice, image esthétique renvoyée et prolongation de l’habitat intérieur.
PUBLICITÉ
Des études en archéologie avaient déjà démontré que la couche protectrice que forme le couvert bactérien (algues et mousses) sur les monuments historiques contredisait les approches interventionnistes qui cherchent à les éliminer, que ce soit par le recours aux biocides, ou au nettoyage systématique.
Un vaste projet européen de trois ans (2019-2022), auquel j’ai participé, a justement porté sur la pollution aux biocides utilisés dans les enduits de façades dans les eaux souterraines de la région du Rhin supérieur. Cette recherche interdisciplinaire (écotoxicologie, hydrologie, sciences sociales) a été portée par cinq universités de cette région trinationale entre Allemagne, France et Suisse.
Dans ce cadre, il a fallu interroger la ville dans sa dimension socioécologique, entre conception des bâtiments (choix des enduits, pratiques professionnelles…) et effets sanitaires des agents biocides.
À partir d’une quarantaine d’entretiens conduits auprès des professionnels (peintres en bâtiment, fournisseurs et fabricants des enduits), nos résultats ont permis d’évaluer l’acceptabilité sociale des produits de remplacement aux biocides.
En effet, celles-ci peuvent être des solutions « intelligentes » à base de nanoparticules ou des solutions « low tech ».
Les réponses des professionnels oscillaient ainsi entre deux orientations :
- une tendance à l’hyper technicisation qui modernise les produits existants (peinture intelligente à base de nanoparticules)
- à l’inverse, des innovations qui amorcent une rupture avec le système de pratiques institué et valorisent des produits dits naturels (peintures minérales, utilisation de la chaux).
Les biocides des enduits de protection, un risque sanitaire ?
Les biocides identifiés dans l’étude sont des molécules de synthèse utilisées comme films protecteurs pour lutter contre les algues, les champignons ou les mousses. Citons par exemple la Terbutryne (algicide), le Diuron (herbicide) et l’Ochtilinone (fongicide), utilisés pour empêcher le développement des espèces végétales et répondre à une demande sociale de façade qui restent propres.
Il est intéressant de remarquer que ces molécules sont également utilisées dans le monde agricole et que certaines sont interdites depuis plusieurs décennies pour l’agriculture, comme le Terbutryne. Leur utilisation dans le secteur du bâtiment est liée à l’évolution des techniques de construction (par exemple, absence de débord de toit qui protégeait les façades des intempéries) et à l’artificialisation des enduits, avec la fabrication de produits acryliques (dérivés du pétrole).
Les débords de toit (immeuble à l’arrière-plan, par opposition aux deux immeubles à l’avant-plan qui en sont dénués) constituent une alternative à l’usage des biocides. Ils permettent une protection des façades exposées aux intempéries.
Le problème, c’est que le maintien des biocides sur la façade n’est pas pérenne. Ces agents sont dégradés sous l’effet des conditions météorologiques puis lessivés par la pluie pour se diffuser au pied des façades, puis dans les eaux souterraines de surface.
Ce processus peut être interprété comme un risque, dans le sens du sociologue Ulrich Beck. Il a pour origine l’innovation technique et reste largement imperceptible. Ce risque n’a pas de limite spatiale et temporelle bien définie. Ces substances chimiques finissent dans les aquifères souterrains et peuvent impacter des milieux éloignés des zones émettrices, d’autant plus que leurs effets peuvent être différés dans le temps.
Par ailleurs, ce risque est susceptible d’en générer une cascade d’autres, dont les conséquences ne sont pas encore clairement identifiées. Notamment en ce qui concerne la dégradation des biocides et leur interaction avec d’autres agents (issus de l’agriculture, des usages domestiques…), dont les effets et la dangerosité restent encore méconnus.
Dès lors, les biocides contenus dans les peintures de façade constituent un réel problème pour les écosystèmes et la santé environnementale compte tenu de leur migration dans les eaux souterraines sous l’effet de la pluie.
Peintures synthétiques contre minérales
Pour faire face à ce problème de manière durable, il faut limiter le recours aux biocides à la source voire s’en passer entièrement. Les pratiques professionnelles des peintres, à l’interface entre l’espace des professionnels (fournisseurs, fabricants, promoteurs…) et celui de la société (habitants des bâtiments, demande sociale des consommateurs), apparaissent comme un maillon essentiel.
Mais la profession de peintre en bâtiment n’est pas homogène. À l’image des oppositions qui structurent le monde agricole entre pratiques conventionnelles et biologiques, le secteur des peintres en bâtiment se caractérise lui aussi par un clivage dans les produits utilisés et leur mode d’application.
Nos entretiens montrent que le type d’enduit utilisé (synthétique ou minéral) permet d’établir une typologie des pratiques qui témoigne d’un rapport différencié à l’identité professionnelle. Celle-ci prend à la fois en compte le lien aux matériaux biosourcés, les relations de dépendance aux fabricants et fournisseurs et plus généralement le rapport à l’autonomie.
On peut ainsi distinguer les peintres dits « conventionnels » (qui utilisent essentiellement des peintures synthétiques avec biocides) et les artisans qui s’orientent vers des matériaux plus naturels comme les enduits minéraux.
Précisons que la profession doit être comprise comme s’insérant dans toute une filière où les fabricants et les fournisseurs d’enduits jouent un rôle prépondérant dans la définition des opérations de chantier. En effet, les fabricants ne commercialisent pas seulement des enduits, mais tout un ensemble de préconisations « clé en main ».
On y retrouve souvent un enduit de réparation, ainsi qu’un fixateur et un produit de finition. Ces chaînes d’opérations sont le plus souvent certifiées par le fabricant. Leur application est susceptible de « protéger » les peintres d’un éventuel litige, notamment dans le cadre de la garantie décennale. Cette prescription devient le plus souvent la norme : il est d’usage que les peintres mobilisent les systèmes complets des constructeurs, en utilisant la même marque pour les différentes chaînes d’opération.
L’organisation de la profession en filière occasionne ainsi une standardisation des pratiques. Dès lors, les peintres bénéficient d’une marge de manœuvre limitée. Face à un risque émergeant comme celui des biocides, la profession est susceptible de surtout suivre les innovations proposées par les réseaux des fabricants-fournisseurs.
Première alternative aux biocides, les peintures « intelligentes »
Les solutions de remplacement aux biocides s’inscrivent ainsi dans une logique technicienne : les industriels développent des peintures dites « intelligentes » à base de nanoparticules qui permettent la constitution d’un film pour maintenir les façades sèches et « propres ».
Cependant, les solutions techniques basées sur l’encapsulage des biocides ou le recours aux nanoparticules de métal génèrent de nouveaux problèmes encore peu étudiés, comme la diffusion de microplastiques ou de nanoparticules dans l’environnement.
Ceci rejoint la logique décrite par la sociologue autrichienne Marina Fischer-Kowalski, spécialiste de l’écologie sociale, pour qui nos problèmes environnementaux relèvent notamment d’une « colonisation » des processus naturels par la technique : ici, l’artificialisation des enduits de protection.
Loin de remettre en cause ce mouvement, de telles innovations techniques génèrent ainsi de nouveaux risques.
Les peintures minérales, une autre option intéressante
Une minorité de professionnels valorisent les qualités naturelles des peintures minérales (chaux, silicates) comme solution de remplacement aux biocides. Ces enduits minéraux ont pour particularité de favoriser les transferts d’air et d’humidité et de laisser les murs « respirer ». Un artisan nous l’a ainsi expliqué : « Je fais les réparations avec des enduits à base de chaux, nous on est complètement respirant […] car la chaux est un super régulateur de l’humidité et un antifongique, on ne peut pas faire plus naturel ».
Ce même artisan cite la microporosité des enduits qui aide les échanges, contrairement aux crépis plastifiés :
« Avec les peintures minérales, on a une microporosité à la vapeur d’eau qui avoisine les 2000 grammes au mètre carré. Les peintures minérales sont respirantes, il y a un échange qui se fait. Sur les peintures semi-minérales, on tombe à 1200, ce qui est pas mal, alors imaginez avec les peintures qui plastifient les murs ».
Les crépis ont un effet imperméabilisant avec un risque de moisissures. À l’opposé des enduits minéraux qui, en raison de leurs propriétés respirantes, évitent les effets de verdissement. Outre l’emploi de peintures minérales, d’autres alternatives émergent, comme l’usage de plantes (sous forme d’huiles essentielles) qui contiennent des molécules bioactives aux propriétés antifongiques.
Ces alternatives peuvent se lire comme des « innovations par retrait ». Celles-ci ne reposent pas sur le développement de la performance technologique, mais instaurent un nouveau rapport à la nature. Non seulement on active les potentialités des enduits naturels (respirabilité, protection) mais ceux-ci redeviennent des partenaires avec lesquels un secteur professionnel va pouvoir composer.
Mais ces innovations environnementales reposent, en creux, sur l’innovation sociale. En effet, ce statut d’auxiliaire se heurte à des freins qui témoignent des difficultés à admettre que les matériaux naturels puissent remplacer des enduits synthétiques et fortement technicisés.
Elles seraient pourtant précieuses pour les politiques publiques visant à amorcer une transition vers une ville sans biocide. Elles permettraient de réinscrire son fonctionnement dans des cycles naturels. Renoncer aux biocides favoriserait en effet la prise en compte d’autres enjeux globaux, comme la perspective d’une ville plus perméable, qui gérerait différemment les eaux pluviales (noues, bassins de sédimentation…).
[ Nous remercions chaleureusement Jens Lange (Université Albert-Ludwig de Fribourg-Allemagne) le coordinateur du programme Interreg Navebgo. La recherche associe des chercheurs du département d’Hydrologie de l’Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), du Groupe de travail sur l’écotoxicologie fonctionnelle aquatique (Université de Coblence-Landau), de l’Institut de chimie durable et de chimie de l’environnement (Université de Leuphana Lüneburg), du Laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (Université de Strasbourg) ainsi que l’Institut Terre et Environnement de Strasbourg.]
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.