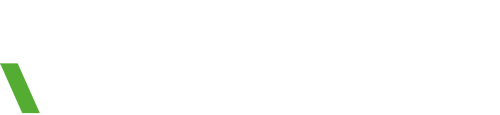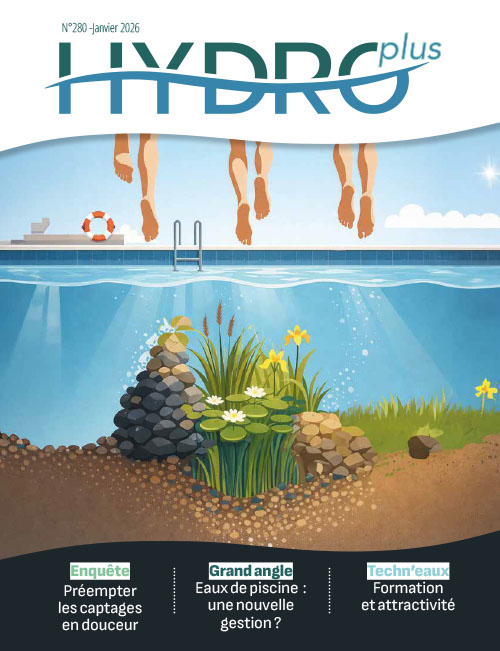« Une chose est sûre : en matière d’émissions de gaz à effet de serre, on ne peut pas réduire si l’on n’a pas au préalable mesuré. » Voilà un constat qui - a priori - tombe sous le sens. Dans les faits, cette assertion exprimée par Jessica Denoyelle, responsable contribution climatique et secrétaire générale de ClimateSeed[1], se révèle un rappel particulièrement bienvenu, voire impérieusement nécessaire, au vu de la situation globale dans laquelle se trouvent, sur ce plan de l’évaluation de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), les entreprises au niveau mondial.
Dans un rapport[2] publié en novembre dernier, le Boston Consulting Group (BCG) et son partenaire CO2 AI révèlent en effet que, sur les quelque 1 850 entreprises interrogées dans 23 pays pour les besoins de cette étude, seules 10 % d’entre elles déclarent chiffrer, de manière exhaustive, leurs émissions de GES. Un chiffre d’autant plus alarmant qu’il n’a globalement progressé que d’un petit point entre 2021 et 2023. Pire, à l’échelle européenne, la part d’entreprises rendant compte de leur émissions sur les scopes 1, 2 et 3 a même reculé de deux points dans ce même laps de temps, malgré une nette progression observée sur le seul scope 3. La donne semble toutefois sur le point de changer, à la faveur notamment de l’évolution, en Europe et en France, de la réglementation et des obligations en matière de rapportage extra-financier qui en découlent.
PUBLICITÉ
Le 1er janvier dernier, ce mouvement initié un an plus tôt s’est vu considérablement amplifié par le biais de l’entrée en vigueur, à l’échelle européenne, d’un nouveau texte majeur : la fameuse Corporate Sustainability Reporting Directive - ou CSRD - remplaçant la première directive européenne sur le rapportage extra-financier, la NFRD (Non Financial Reporting Directive). L’une des conséquences majeures de l’entrée en vigueur - progressive - de cette directive, sera en effet la très nette hausse du nombre d’entreprises concernées par une obligation de rapportage extra-financier : de 11 600 dans le cadre de la NFRD, ce nombre passera à terme - en 2026 - à près de 50 000 à l’échelle de l’Europe, dont 6 000 environ rien qu’en France. Et ça n’est pas tout.
« Outre le fait qu’il concerne beaucoup plus d’entreprises, ce texte a également pour vertu d’introduire le principe de double matérialité - matérialité d’impact et matérialité financière - mais aussi de placer sur un pied d’égalité le rapportage financier et extra-financier, ne serait-ce que sur le plan de la lisibilité, avec la mise en place de normes bien définies », souligne Jessica Denoyelle. Des normes baptisées ESRS, pour European Sustainability Reporting Standards, et déclinées en douze volets couvrant un ensemble de critères sociaux ; de gouvernance ; mais aussi, bien entendu, de nature environnementale.
Parmi elles se trouve ainsi notamment l’ESRS E1. Ciblant spécifiquement les aspects liés au changement climatique, cette norme fixe, entre autres « Disclosure Requirements » (DR), l’obligation pour les entreprises concernées de calculer et de publier les quantités brutes de GES émises sur les scopes 1, 2 et 3, ainsi que la valeur totale de ces émissions, en tonnes métriques d’équivalent CO2 (tCO2e). Un travail de fourmi - d’autant qu’il sera à renouveler annuellement - face auquel les entreprises pourront toutefois compter sur un cadre normatif et méthodologique aussi précis qu’exhaustif.
« Il existe en premier lieu une norme internationale - l’ISO 14064 - qui fixe des règles précises en matière de comptabilité des émissions de GES », note Hervé Lefebvre. Une norme d’application volontaire, à laquelle se conforment cependant toutes les méthodologies courantes de calcul d’émissions. « C’est notamment le cas du bilan GES réglementaire ; mais aussi du Bilan Carbone, développé initialement par l’Ademe et aujourd’hui porté par l’Association pour la transition Bas Carbone (ABC) ; ou encore du GHG Protocol, un standard privé d’origine américaine, très utilisé », souligne le responsable au sein de l’Ademe.
Aussi normées soient-elles, ces méthodes n’en demeurent pas moins tributaires, pour déboucher sur des résultats fiables et précis, de la qualité des données utilisées en entrée. « Sur ce plan, deux approches sont possibles : l’approche physique, et l’approche monétaire », explique Alexis Normand, P.-D.G. et cofondateur de la plateforme de comptabilité carbone Greenly. Plus précise, l’approche physique reste toutefois l’option à privilégier dans la mesure du possible, comme le souligne le dirigeant.
« Passer par des facteurs monétaires amène forcément un biais, qui ne permet donc pas d’atteindre la même précision que l’utilisation de véritables flux physiques », renchérit le responsable du pôle Trajectoires bas carbone à l’Ademe Hervé Lefebvre, qui concède toutefois à l’approche monétaire un intérêt lorsqu’il s’agit d’identifier dans un premier temps, à grands traits, des postes d’émissions majeurs : « Ça n’est pas la panacée, mais cette approche offre en tout cas un premier aperçu qui permet ensuite à l’entreprise d’affiner, via une approche physique cette fois, le calcul des émissions liées spécifiquement à ses grands postes d’émissions, et de prendre ainsi, in fine, les décisions prioritaires en matière de mesures de réduction ». En somme, bien quantifier pour mieux réduire.
[1] Entreprise à impact spécialiste de l’accompagnement des organisations dans le calcul de leurs émissions de gaz à effet de serre et de la mise en œuvre de stratégies de réduction.
[2] « Why Some Companies Are Ahead in the Race to Net Zero - Carbon Emissions Survey Report 2023 ». Par CO2 AI et Boston Consulting Group (BCG), novembre 2023.