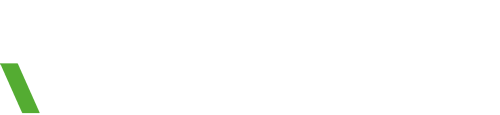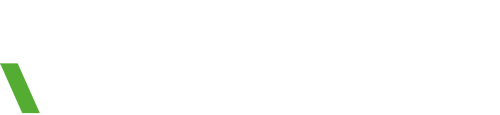C’est une première pour les agences de l’eau. Depuis leur création en 1964, les agences de l’eau n’avaient en effet jamais fait l’objet d’un audit. De ce rapport établi par Hugues Ayphassorho (coordonnateur), Bruno Cinotti, Christian Dieudonné et Florence Tordjman, il ressort plusieurs points positifs de bonnes pratiques. Ainsi un dialogue existant entre les agences et les services de l’Etat, une décentralisation effective pour les agences couvrant de vastes territoires, des accords-cadres avec les conseils régionaux favorisant des axes de convergence des politiques menées en faveur de l’eau et un plan de mutualisation en cours de développement qui engage les six agences dans une démarche de coopération.
PUBLICITÉ
En revanche, des points de vigilance sont relevés. Une redéfinition des indicateurs afin de mener des actions sur les résultats, et non pas sur les moyens. Les objectifs de bon état des masses d’eau fixé pour 2027 pourraient ne pas être atteints : « Si cette obligation de résultats n’est pas atteinte, la diminution des moyens accordés aux agences par le législateur (plafonnement des recettes et prélèvement pour financer d’autres opérateurs) et l’exécutif (réduction des effectifs) viendrait aggraver le risque de contentieux d’un manquement à notre obligation de moyens », note ainsi les rapporteurs ; un relâchement du 11e programme en faveur du plan de relance. Le rapport alerte également sur les problèmes d’effectifs nécessaires à l’évolution des pratiques et le manque de vision à ce sujet, ainsi que sur un contrôle interne incomplet. Egalement l’absence ou le manque de représentativité des usagers aux comités de bassin, alors qu’ils sont à 85% financeurs des politiques publiques et de l’entretien des réseaux, est également un des points soulevés dans le rapport.