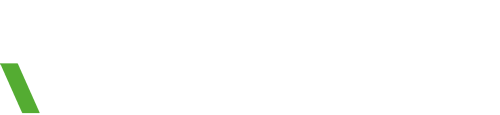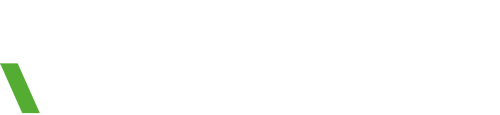C’est une injonction à la conversion aux énergies renouvelables que 14 collectivités et cinq associations (1) invitent le juge à signifier à Total. L’assignation, adressée aujourd’hui au tribunal judiciaire, demande que l’énergéticien s’aligne sur une trajectoire d’émissions (directes et indirectes, notamment liées à l’usage de ses produits) compatible avec les objectifs de neutralité carbone en 2050 et d’un réchauffement contenu à 1,5°C en 2100 (par rapport à l’ère pré-industrielle).
PUBLICITÉ
Pour les représentants de la société civile, cela implique un recul de sa production de gaz de 25 % en 2030 et 74 % en 2050 (par rapport à 2010) et de 37 % en 2030 et 87 % en 2050 de celle de pétrole. Ainsi que l’arrêt immédiat de l’exploration d’hydrocarbures et la cessation progressive, d’ici 2040, de l’exploitation des gisements, avec l’engagement de laisser dans le sous-sol 80 % des réserves connues.
En clair, Total est sommée de « fournir des énergies propres et non carbonées et d’engager une transition aussi rapide que le GIEC nous y presse, pose Paul Mougeolle, juriste de Notre affaire à tous. Du rapport spécial d’octobre 2018, sur les impacts comparés d’un réchauffement à 1,5 et à 2°C , nous tirons des conclusions au point de vue juridique ».
Un seul scénario, sans stockage du CO2
Selon le texte de l’assignation, « la prévention des risques générés par un réchauffement au-delà du seuil de 1,5 °C nécessite (…) d’investir massivement dans les énergies renouvelables ». Les demandeurs excluent l’option de la capture et du stockage du carbone – que Total entend développer. L’assignation cite le prix Nobel d’économie, Joseph Stiglitz, qui « préconise exclusivement une réduction immédiate des gaz à effet de serre comme mesure d’atténuation, en raison des coûts importants associés aux technologies d’émissions négatives ».
En condamnant l’Etat néerlandais à réduire ses émissions d’au moins 25 % en 2020 (par rapport à 1990), la Cour de cassation a estimé, en décembre 2019, que la capture et le stockage du carbone ne sauraient constituer « un point de départ pour la politique à l’heure actuelle sans prendre des risques irresponsables ». S’impose dès lors le scénario du GIEC faisant abstraction de ces technologies, « ni disponibles, ni éprouvées », selon Paul Mougeolle.
Trans-vigilance
Cette action est la première fondée sur la loi sur le devoir de vigilance de mars 2017. « Le défi est de taille, admet le juriste : on attaque la maison-mère, qui doit adopter un plan de vigilance transnational pour que, partout où elle exerce, ses activités soient conformes à la loi nationale. »
En 2018, Total a émis 458 Mt équ-CO2, avancent les demandeurs, sur la base du périmètre élargi de l’entreprise (2). Soit 3 % de plus que les émissions du territoire national (3) et 1 % des émissions mondiales. La Carbon Major se garde de signaler ce dernier chiffre dans le plan de vigilance publié en mars 2019, où le changement climatique apparaît comme résultant « d’actions humaines diverses, dont la production et la consommation d’énergie ».
(1) : communes d’Arcueil, de Bayonne, Bègles, Bize-Minervois, Correns, Champneuville, Grenoble, La Possession, Mouans-Sartoux, Nanterre, Sevran, Vitry-le-François, l’EPT Est-Ensemble, la région Centre-Val-de-Loire, les associations Eco-Maires, FNE, Notre affaire à tous, Sherpa et Zea.
(2) : soit 54 Mt d’émissions directes, 4 Mt d’émissions indirectes liées à la consommation d’énergie des sites et 400 Mt d’émissions indirectes liées à l’usage des produits vendus.
(3) : 445 Mt en 2018.