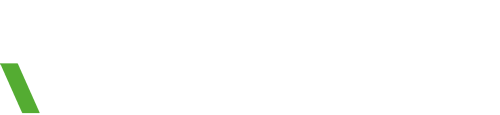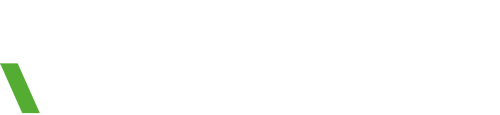Dans une nouvelle étude publiée ce vendredi 6 septembre, des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), du CNRS, de Sorbonne université, d’AgroParisTech et de l’Université Paris-Sud, s’intéressent à la séquence éviter-réduire-compenser (ERC). « La démarche "Eviter, Réduire, Compenser – ERC", renforcée par la loi biodiversité en 2016, est une composante des études d’impact accompagnant les projets d’aménagement. Son principe fondateur est une "non perte nette" de biodiversité », rappellent les chercheurs.
PUBLICITÉ
Ayant eu accès à 25 projets autorisés entre 2012 et 2017 – 20 en région Occitanie et cinq dans les Hauts-de-France – les chercheurs ont établi un constat : « dans seulement 20% des cas, les maîtres d’ouvrage ’"compensent" leurs travaux sur des espaces à restaurer : zones agricoles intensives (17%) ou des espaces très dégradés », peut-on lire. Pour les 80% restants, les mesures préservent des milieux déjà de bonne qualité. « Du bureau d’étude aux maîtres d’ouvrages en passant par les administrations, les procédures débouchent aujourd’hui sur des compensations à minima, souvent en milieu naturel (forêts, bois, prairies) », où le gain écologique est moins important, expliquent les chercheurs. « Ainsi, sur 577 hectares destinés à compenser des zones artificielles, seulement 3% de la superficie était artificielle avant le travail de compensation, offrant des gains potentiels élevés, tandis que 81% pouvaient être considérés comme des habitats semi-naturels », détaille l’étude.
Selon cette étude, « les mesures compensatoires ne sont pas à la hauteur de l’ambition du texte de loi et ne permettent pas un retour concret de la biodiversité contrebalançant les effets des projets d’aménagements en France ».