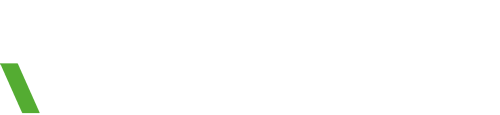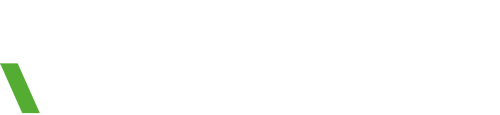De fait, il faut agir sur les quatre leviers de dérèglement du vivant : l’urbanisme, l’agriculture, l’eau et le climat. Et l’urbanisme s’avère être la seule politique à la véritable main des collectivités ; on peut d’ailleurs se demander qui articule en responsabilité les politiques territoriales agricoles et de l’eau -ou de la forêt, mais c’est un autre débat ... Concernant le climat, il faut prendre sa part dans la prévention, et s’adapter intensément.
L’urbanisme donc est le principal levier d’une politique biodiversitaire territoriale ambitieuse. C’est l’objectif que nous nous sommes fixés à Grand-Angoulême, à travers le Scot (valant PCAET) arrêté fin 2024, le Plui (valant le plan de mobilité) arrêté début 2025. Une démarche réglementaire particulièrement élaborée -et exigeante, favorisant les articulations donc l’efficience.
PUBLICITÉ
La première est celle de laisser de l’espace à la nature. Ainsi, dans le Scot, si nous satisfaisons à l’objectif de réduction de 50 % des surfaces aménageables, l’ambition réside surtout dans l’effet cumulatif : nous étions déjà parvenus dans le Plui précèdent à une réduction des surfaces constructibles de l’ordre de 70 % pour le résidentiel ! Nous parlons ici tout de même de 361 ha de zones dorénavant naturelles ou agricoles !
Une précision toutefois : 361 ha rendus à la nature ou l’agriculture, ce sont 361 ha confortés dans cette vocation, et non pas recréés, puisque ces terrains urbanisables sont dans les faits soit nus (des franges urbaines), soit cultivés. A cet égard, évoquons le triple enjeu biodiversitaire des territoires à la fois urbain et rural : faire revenir la nature vraie dans l’agriculture (donc à la campagne !), conforter la nature qui s’est réfugiée dans les villes, la biodiversité urbaine donc, le tout en protégeant nos grands espaces naturels …
Les autres ambitions s’inscrivent dans le Plui, la traduction réglementaire du Scot.
En liminaire, il faut bien avoir en tête que la préservation de la biodiversité demande toujours méthode et technicité. La nature, ce sont des complétudes qu’il faut préserver, parfois recréer. Ce sont des cycles, des chaînes, des articulations. Sans fourmi, sans serpolet, pas d’azuré, espèce parapluie par ailleurs (une belle histoire à raconter à vos enfants) !
Et c’est bien dans l’approche méthodique et rigoureuse du Plui en matière naturaliste que se trouve notre deuxième ambition. L’étude socle fut la réalisation d’un atlas intercommunal de la biodiversité, qui pose les éléments de connaissances pour aller vers les réservoirs et corridors constitutifs des trames. A cela nous avons ajouté un recensement -et une caractérisation de sols- des zones humides qu’il nous faut protéger. Plus loin, nous réalisons une étude foncière qui regarde spécifiquement les discontinuités pour proposer les sorties en gestion ou acquisition (le nouveau modèle économique de la nature …). Enfin, une étude exhaustive de nos friches reverse certains espaces à la nature (les friches confortées dans leur vocation naturelle) ou à la renaturation (12 ha dument identifies). In fine, quand la carte est précise, quand le zonage est argumenté, y compris dans son acceptabilité, c’est de la vraie écologie réglementaire.
Au-delà, différents points de règlement ou d’incitation forgent la troisième ambition :
Une approche spécifique de protection des forêts, boisements, bosquets et arbres remarquables ou communs qui mobilise tous les outils réglementaires possibles ;
Une approche paysagère de conservation des parcs et jardins, de maintien d’alignements d’arbres et de haies, de systématisation de plantation de haies diversifiées ;
L’obligation de végétalisation partout (les parkings !) ; la systématisation et le rehaussement des coefficients de pleine terre (pour un sol vivant) ou d’espaces éco-aménageables (pour les ilots urbanisables) ;
Un regard réglementaire particulier sur le grand poumon vert de l’agglomération, le méandre de la Charente de l’ancien site poudrier d’Angoulême, 150 ha d’espaces naturels ;
Un zonage agricole spécifique pour l’agriculture de maraichage, pour les terres à potentiel messicoles (les coquelicots !) aussi ;
La prescription d’essences locales ou adaptées au réchauffement, la proscription d’espèces envahissantes.
Enfin, et c’est le dernier volet portant l’ambition, les aspects réglementaires et spécifiques sont ramassés dans trois types d’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) :
Une OAP thématique socle qui recoupe préservation de la biodiversité et adaptation au dérèglement climatique : l’OAP Bioclimatique. In fine, ce sont 11 000 ha qui sont protégés dans le Plui principalement dans trois grands milieux : les boisements, les zones humides, les pelouse sèches très spécifiques de notre agglomération ;
Des OAP sectorielles de parcelles qui dessinent (au sens premier du terme) les règles d’aménagement des espaces, avec constitution de haies et de franges, préservation du patrimoine naturel ou paysager existant ;
Et une OAP sectorielle à l’échelle d’un quartier d’Angoulême pour protéger la biodiversité commune (une première en France, une véritable innovation réglementaire !).
En résumé, le PLui nouveau de Grand-Angoulême, en restituant de l’espace à la nature, en proposant une approche méthodique pour protéger, en mobilisant toutes les possibilités réglementaires et en surlignant les points de force aussi pour entraîner nos concitoyens, se veut un outil puissant de protection des espèces.
Pour faire en sorte que l’urbanisme soit un véritable levier de préservation du vivant !